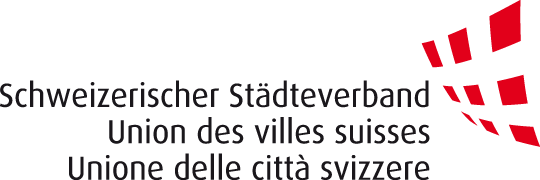Inaudibles dans la Berne fédérale ?
À l’avenir, seule la vitesse limitée à 50 km/h sera-t-elle possible sur les routes principales, contre la volonté des villes et des communes? Une motion adoptée par le Parlement veut une telle adaptation, que le Conseil fédéral est à présent tenu de mettre en œuvre. Ce que cela signifie dans la réalité sur le terrain peut sembler lointain au Parlement. En revanche, les villes et les communes voient les conséquences de la politique directement. C’est pourquoi elles savent qu'il est parfois judicieux de réduire la vitesse maximale autorisée sur les routes principales. Par exemple devant les écoles et les jardins d'enfants, où la sécurité des enfants est menacée ; sur les tronçons à forte densité de population, où la santé de nombreuses personnes est impactée par la hausse des nuisances sonores. Jusqu'à présent, les villes pouvaient demander aux cantons d'introduire une vitesse à 30 km/h sur de tels tronçons des routes principales. Cette possibilité doit être maintenue. Des espaces routiers bien aménagés contribuent à une bonne qualité de vie et de séjour pour les personnes. Les villes et les communes se sont donc en toute logique opposées à cette motion. Aussi bien l'Association des communes suisses (ACS) que l'Union des villes suisses (UVS) ont attiré à plusieurs reprises l'attention du Parlement sur leur opposition à cette motion. Les besoins des villes et des communes ont été ignorés. De plus, le Conseil fédéral n'a jusqu'à présent pas impliqué le troisième niveau de l'État - et ce bien que les villes et les agglomérations soient directement concernées et que la mise en œuvre de la motion compromette l'autonomie communale : la marge de manœuvre des villes en matière de politique de mobilité s’en trouve ainsi réduite.
Cet exemple illustre de manière frappante ce que les villes et les communes sont régulièrement amenées à vivre : la prise en compte du troisième niveau étatique dans la Berne fédérale s’effectue selon d’étroites limites. Mais quel est en fait le type d’implication prévu ? L'ancienne Constitution fédérale (1874) ne faisait pas mention des communes ou des villes. En 1994, l'Union des villes suisses a demandé que les villes soient mieux prises en compte. Après deux tentatives, la revendication a finalement été entendue : un nouvel « article sur les communes » (art. 50) a été intégré dans la Constitution fédérale révisée et mis en vigueur dès 2000. Selon ces dispositions, l'autonomie communale est garantie dans les limites du droit cantonal et la Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes, tout en prenant en considération la situation particulière des villes et des agglomérations.
En 2013, les présidents de l’Union de villes et de l’Association des communes, qui étaient en poste à l’époque, ont demandé à la Confédération, via des postulats déposés au Conseil national et au Conseil des États, d’exposer les effets découlant de l’article 50. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a attesté de la réussite de la mise en œuvre. Il a par exemple cité l’implication des villes et des communes dans les procédures de consultation, la Conférence tripartite sur les agglomérations et la réforme de la péréquation financière. En revanche, il a également constaté diverses possibilités d'amélioration, parmi lesquelles notamment une meilleure implication des villes et des communes lors de l'élaboration de projets législatifs, un usage plus efficace des procédures de consultation, ce afin de connaître l’étendue des moyens à mettre en œuvre qui en résulte pour les villes et les communes, ou d’améliorer, dans les messages et les requêtes, les indications sur les répercussions en termes d’aménagement du territoire.
L'implication des villes et des communes s’est sans aucun doute renforcée depuis l'introduction de l'article 50 Cst. Étant obligatoire notamment dans le cadre des processus standardisés (consultations) ou d'institutions nouvellement créées, comme la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA), elle est globalement respectée. Il reste toutefois nécessaire de l’optimiser. La visibilité de ces processus, par exemple, est très faible comparée à celle des cantons. Il en résulte que les besoins des villes et des communes sont peu entendus dans la Berne fédérale. En témoignent, outre la « motion pour une réduction de la vitesse à 50 km/h sur les routes principales », de nombreux autres exemples : les villes et les communes n'ont pas pu participer à la planification des mesures dans le cadre de la pandémie du Covid-19 ; un droit de préemption facultatif accordé aux villes et aux communes en matière de terrains et de biens immobiliers n'a eu aucune chance d’aboutir ; ou encore : les villes et les communes doivent se battre pour être incluses dans l’élaboration des conventions-programmes.
Cette année marque les 25 ans d’existence de l’article 50 Cst. C'est l’occasion pour examiner l'intégration des villes et des communes dans la politique fédérale. L'Union des villes suisses et l'Association des communes suisses profitent de l'année du jubilé pour évaluer les efforts entrepris jusqu’ici et discuter des domaines qui recèlent encore un potentiel pour une future meilleure prise en compte du troisième niveau étatique.