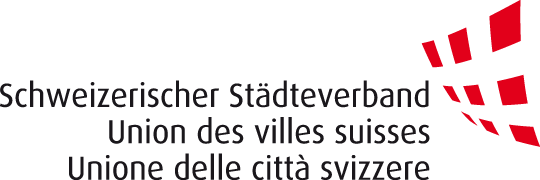«Le Parlement fédéral est un moteur important de la centralisation»
Adrian Vatter est professeur de sciences politiques spécialisé dans la politique suisse et directeur de l’Institut de sciences politiques de l’Université de Berne.
Rahel Freiburghaus est professeure assistante de politique suisse et comparée à l’Université de Lausanne.
Rahel Freiburghaus, Adrian Vatter, vous avez expliqué dans votre chronique politique publiée dans les journaux de Tamedia qu’un nombre croissant de compétences sont transférées des cantons vers la Confédération. Peut-on constater une tendance similaire à l’échelon communal?
Adrian Vatter: Notre article se base sur une étude menée sur plusieurs années par Sean Müller et Paolo Dardanelli, qui ont analysé scientifiquement ce transfert de compétences. Il n’existe pas d’étude de ce type pour les villes et les communes, mais nous supposons qu’elles sont confrontées à une évolution similaire.
Comment évaluez-vous le degré d’autonomie des villes et communes suisses?
Adrian Vatter: En comparaison internationale, les villes et les communes suisses jouissent d’une grande autonomie. Cela se traduit par une grande légitimité démocratique, plus d’efficacité et d’innovation et moins de corruption. Les communes sont les piliers de la démocratie locale. En même temps, l’autonomie entraîne aussi certaines inégalités entre les communes. Mais en principe, je l’évalue de manière positive.
Rahel Freiburghaus: Une étude récente révèle même que le niveau de bonheur des populations augmente parallèlement au degré d’autonomie subnationale. Pour être précis, il faudrait toutefois parler d’autonomies au pluriel, car on observe d’importantes disparités intercantonales. L’autonomie a tendance à être plus élevée en Suisse orientale et centrale, et plus faible en Suisse romande. En outre, le degré d’autonomie des villes et communes varie en fonction du domaine politique. Enfin, il convient de faire une distinction entre les différents types d’autonomie: s’agit-il d’une autonomie fiscale, législative ou de mise en œuvre?
La Constitution fédérale révisée, entrée en vigueur en 2000, contient un article 50 qui oblige la Confédération à prendre en considération le niveau communal. Quel est le bilan après 25 ans?
Adrian Vatter: L’article 50 renforce l’acceptation et la légitimation du niveau communal et oblige la Confédération à prendre en considération les besoins spécifiques des villes, des communes d’agglomération et des communes de montagne. Un dialogue institutionnalisé a vu le jour grâce à la Conférence tripartite, au sein de laquelle l’Association des Communes Suisses et l’Union des villes suisses sont également représentées, si bien que la voix des villes et des communes est davantage prise en compte lors des consultations. Mais comme il n’y a pas de juridiction constitutionnelle en Suisse, les villes et les communes ne peuvent pas invoquer valoir l’article 50.
Rahel Freiburghaus: L’article 50 peut également être une incitation pour que le niveau communal apporte activement son expertise au niveau fédéral, dans la mesure où il connaît bien les spécificités locales: dans le domaine de l’adaptation au climat, par exemple, de nombreuses villes ont acquis, avec le concept de la ville éponge, une grande expertise dont la Confédération et les cantons peuvent également profiter. Si les communes et les villes sont susceptibles d’offrir une expertise à la Confédération, elles seront écoutées.
De nombreuses villes et communes se sentent néanmoins ignorées et ont l’impression de n’être que des organes d’exécution.
Rahel Freiburghaus: L’administration fédérale assume son obligation en tenant systématiquement compte des conséquences de son action pour les villes et les communes. Nous constatons que les mesures de centralisation émanent principalement du Parlement fédéral et s’inscrivent dans une logique politique partisane. Ce phénomène s’explique, entre autres, par l’évolution des parcours professionnels des parlementaires: ils n’accomplissent plus tous le «parcours du combattant», de sorte qu’il en résulte un déficit d’expérience communale, et donc une sensibilité moindre aux préoccupations des collectivités locales.
Quelles pourraient être les solutions possibles ?
Adrian Vatter: Il s’agit d’une part de mieux tirer parti des organes existants, mais aussi d’en imaginer de nouveaux. Les intérêts des communes et des villes sont hétérogènes, ce qui affaiblit leur position face à la Confédération. Les cantons ont regroupé leurs forces au sein de la Conférence des gouvernements cantonaux et jouissent donc d’une position très forte. Le niveau communal pourrait s’en inspirer: la création d’une «Conférence des président·e·s de communes et de villes» lui donnerait peut-être davantage de poids.
Rahel Freiburghaus: Un siège pour les villes au Conseil des États est parfois évoqué. Mais nous ne pensons pas que cela soit pertinent, car le moment où l’influence pourrait s’exercer arriverait trop tard. La recherche montre en effet que le lobbying est d’autant plus efficace que la participation intervient très tôt dans le processus décisionnel.
Interview réalisé par Nadja Sutter, Association des communes suisses; première publiation dans «Commune suisse».