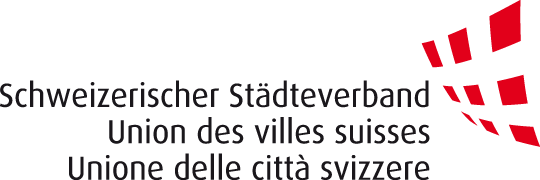25 ans de l’article sur les villes dans la Constitution fédérale: un acquis démocratique mis à l’épreuve
Voilà 25 ans que l’article 50, consacré aux villes et communes, a été inscrit dans la Constitution fédérale. Il garantit l’autonomie des communes dans les limites fixées par le droit cantonal, oblige la Confédération à tenir compte de l’échelon communal dans son action et souligne le rôle particulier des villes, agglomérations et régions de montagne. Son adoption a marqué un tournant démocratique: les villes et les communes ne doivent plus être considérées comme de simples exécutantes ou des quémandeuses, mais reconnues comme des partenaires à part entière du fédéralisme suisse.
Cet anniversaire n’est pas un prétexte à la nostalgie, mais plutôt l’occasion de faire une déclaration – et aussi un appel à la mise en œuvre. Car l’article 50 n’est pas seulement une base juridique assez floue ou une obligation. Il s’agit bien davantage d’une promesse à honorer.
Des acquis – et l’obligation d’une mise en œuvre commune et partenariale
L’intégration de cet article sur les villes a été le résultat d’âpres débats. Ces discussions ont conduit à une implication plus systématique des villes et des communes et, dans certains domaines, à une coopération mieux structurée, notamment sous la forme de consultations et de conférences tripartites. Ces mécanismes qui paraissent aujourd’hui évidents constituaient à l’époque une avancée majeure, que nous apprécions à sa juste valeur. Pourtant, la prise en compte de la voix de la Suisse urbaine, l’effectivité et les possibilités d’intervention offertes aux villes, communes et agglomérations varient considérablement d’un dossier à l’autre. Nous parlons ici d’une prise en compte particulière des territoires où vivent les trois quarts de la population et où plus de 80 % de l’activité économique du pays est réalisée. Les recettes fiscales générées par les villes suisses sont donc substantielles. Élaborer des politiques publiques sans associer les villes équivaut à gouverner sans la majorité de la population. Cette réalité soulève des questions concrètes fondamentales: par exemple, comment les réponses de l’Union des villes suisses aux consultations fédérales sont-elles pondérées dans le processus décisionnel? De quelle manière les membres du Parlement fédéral intègrent-ils les positions exprimées par les villes et communes? Comment organiser concrètement cette prise en considération particulière selon les spécificités de chaque situation? Les collaborations tripartites sont importantes pour les villes et offrent (ou pourraient offrir) un cadre pour la négociation directe et le maintien d’un dialogue permanent allant au-delà des points formellement inscrits à l’ordre du jour. C’est justement là que nous atteignons nos limites, lorsqu’on se contente d’administrer au lieu de cultiver une collaboration partenariale dans le cadre de projets et d’enjeux concrets. Le défi est également de taille lorsque le partenariat vise simplement à s’assurer de la disposition à payer, sans que les principes et les tâches de la péréquation financière et de la compensation des charges, respectivement de la compensation intercantonale des charges et prestations soient également abordés.
Il est donc clair qu’un article constitutionnel ne suffit pas pour établir une collaboration d’égal à égal. Les instruments qui en découlent doivent être entretenus, utilisés et développés en permanence et non pas se résumer à une gestion purement formaliste et à un exercice alibi. En effet, la collaboration entre la Confédération, les cantons et les villes n’est pas un acte unique, mais un processus permanent. Ce n’est qu’ainsi que l’article 50 garde toute sa portée.
Or, c’est justement en période de crise que l’on voit à quel point cette collaboration peut être fragile. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence le rôle indispensable des villes, tout en montrant à quelle vitesse elles peuvent être ignorées. Elles ont assumé des responsabilités, mobilisé des ressources, mis en œuvre des mesures, mais sans vraiment être impliquées. Le programme d’allègement budgétaire 2027 révèle lui aussi des failles: sur 59 mesures, seules 36 ont été mises en consultation. La Confédération et les cantons ont décidé de réaliser des économies de l’ordre de 1,5 milliard de francs sans consulter les communes, alors que les conséquences se feront directement sentir dans les écoles, au niveau du travail d’intégration, dans l’espace urbain et dans le quotidien de la population. Cela va clairement à l’encontre de l’esprit de l’article 50.
Un mandat et une promesse démocratiques
Si l’on considère l’article 50 comme un mandat visant le partage des responsabilités, il s’agit de reconnaître les villes et communes comme co-créatrices, et non comme des destinataires ou même de simples exécutantes. Le partenariat suppose une collaboration sur un pied d’égalité, ce qui implique de reconnaître le pouvoir de décision des villes. Mais une telle promesse ne se concrétise pas toute seule. Elle exige un engagement permanent et la volonté de tous les échelons de l’État de prendre le dialogue au sérieux, d’expérimenter de nouvelles formes de coopération et d’entretenir activement la cohésion fédérale. En tant que lieux d’innovation, les villes occupent une place centrale et souhaitent remplir leur rôle de laboratoires de solutions, que ce soit par un développement urbain participatif, dans les relations avec les coopératives et les acteurs économiques, dans la réalisation d’objectifs climatiques ambitieux ou dans le maintien de l’équilibre social. Les villes sont également les lieux où les investissements dans les infrastructures publiques et l’innovation sont réalisés afin d’améliorer durablement la qualité de vie et de séjour. C’est là que naissent de nouvelles formes de coopération entre la politique, l’administration et la société civile. Car c’est dans la diversité urbaine et les frictions que naissent des idées viables. L’histoire montre que les villes ont souvent été des moteurs de progrès, même lorsque le niveau national marquait le pas. Comme le rappelle Anne Hidalgo, maire de Paris: Les villes n’ont peut-être pas d’armées ni d’ambassades – mais ce sont leurs maires qui apportent des changements concrets au quotidien.
Perspectives et déclaration
L’anniversaire de l’article 50 est une pierre de touche. Nous ne réclamons pas de statut particulier, mais d’être reconnues comme partenaires de l’État. La participation doit être la règle, non l’exception. Le fédéralisme ne fonctionne que si les villes sont impliquées – l’article 50 doit donc être développé et appliqué de manière conséquente.
C’est dans cet esprit que l’Union des villes suisses et l’Association des Communes Suisses ont rédigé une déclaration commune, qui sera remise le 24 septembre au Palais fédéral. Elle exprime la volonté de coopérer avec la Confédération et les cantons, dans un esprit de respect et de gratitude, tout en adressant un message clair: la voix des communes doit être entendue. L’article 50 doit être pris au sérieux et pleinement mis en œuvre à l’avenir. Ce n’est qu’à cette condition que cet acquis historique pourra faire ses preuves dans notre système fédéraliste.