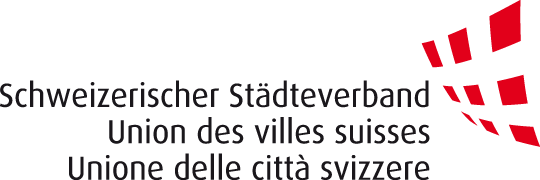Les villes suisses face aux changements climatiques
Prof. Martine Rebetez, Université de Neuchâtel et Institut fédéral de recherches WSL
Les possibilités de réduction des émissions sont encore importantes dans les villes suisses même si elles possèdent généralement déjà une bonne infrastructure de transports en commun. La mobilité douce peut encore être grandement facilitée et encouragée. Il s’agit surtout d’améliorer la sécurité et le confort des déplacements à pied ou à vélo, en veillant à placer les parcours à l’ombre pour les périodes caniculaires, et à l’écart du bruit et de la pollution du trafic motorisé. Ces modes de déplacement renforcent la santé d’une population trop sédentaire et contribuent au bien-être et à la convivialité.
Le transport des marchandises a aussi une grande marge de progression avec les transferts vers des véhicules légers ou cyclistes dès l’entrée des villes, ainsi que vers une motorisation électrique. Pour la mobilité individuelle motorisée, la solution électrique n’est pas la panacée, mais elle est nettement meilleure que les moteurs thermiques en matière de budget CO2 et de bilan énergétique global.
Une production solaire en retard
S’agissant des bâtiments, l’amélioration des enveloppes est en cours mais le processus mérite d’être accéléré. Le chauffage à distance basé sur des systèmes d’échange de chaleur avec l’eau des lacs et des rivières permet de produire non seulement de la chaleur en hiver, mais aussi du froid en été, ce qui va devenir de plus en plus précieux. La production d’énergie solaire, thermique ou photovoltaïque, est proportionnellement en retard dans les villes, en partie en raison du peu d’intérêt de grands propriétaires ou du manque de coordination entre les propriétaires de PPE. Les communes ont un rôle important à jouer pour faciliter cette transition.
A noter sur le plan de l’approvisionnement énergétique que le nucléaire ne peut plus être une solution en Suisse. La proximité exceptionnelle entre les centrales et les villes fait que, contrairement à ce que l’on observe ailleurs, un accident aurait des conséquences disproportionnées, et les changements climatiques lui sont défavorables puisque les centrales nécessitent un refroidissement par des cours d’eau mis à mal par les sécheresses et l’augmentation de la température. Par ailleurs il s’agit d’un combustible non renouvelable, souvent enrichi dans des centrales à charbon russes.
La vulnérabilité des villes
La population urbaine est particulièrement vulnérable face aux situations caniculaires qui s’accroissent et se renforcent extrêmement rapidement. Les mesures en ville de Neuchâtel, par exemple, ont montré que même dans une petite ville, lors des pics de chaleur, les températures sont de plusieurs degrés supérieures dans les secteurs urbanisés par rapport aux mesures effectuées dans les zones de verdure. L’aménagement peut faire une grande différence. Les recommandations soulignent en particulier l’importance des surfaces végétalisées avec de grands arbres, ainsi que la présence d’eau de surface et en profondeur. En effet, la végétation ne peut jouer son rôle de climatiseur que si elle dispose d’assez d’eau, aussi durant les périodes de sécheresses.
Les changements climatiques renforcent le cycle de l’eau et accroissent les risques de sécheresses mais aussi d’inondations et de laves torrentielles. En Suisse, la plupart des villes se trouvent en plaine, au bord de lacs ou de rivières. Les exemples de catastrophes n’ont pas manqué récemment, qu’il s’agisse d’événements orageux brefs et intenses ou de précipitations diluviennes se cumulant sur plusieurs jours, ou encore de la conjugaison de pluies importantes à haute altitude avec la fonte de la neige.
Le lien entre les fortes précipitations et les inondations dépend pour une grande part des aménagements humains, de la végétation, de l’état du lit des cours d’eau et des pentes. Une partie de ces aménagements concerne directement la commune urbaine, mais la majorité des améliorations doit se faire en amont et dans des secteurs dépendant des cantons. En plaçant dans le lit des rivières, en amont et avant l’entrée des villes, des brise-laves, soit des grilles qui permettent de filtrer les plus gros débris, on parvient à largement réduire les catastrophes. Il reste aussi des possibilités d’optimiser la gestion des barrages hydroélectriques pour qu’ils absorbent une partie de l’excédent d’eau en situation de crise.
Les villes, potentiellement vulnérables, doivent se faire entendre dans des processus souvent trop lents et trop longs face à la vitesse de la dégradation des risques climatiques. En matière de changements climatiques, les villes sont certes vulnérables, mais elles sont aussi particulièrement porteuses de solutions.